Dimanche dernier, dans l’émission télévisée à succès De Mol (Qui est le Taupe?), la personne qui trompait tout le monde depuis des semaines a été démasquée. Spoiler : il s’agissait de Sarah, avocate de profession et une excellente « taupe » qui avait totalement échappé à mon œil de détective. J’étais tombé dans ce que les fans de l’émission appellent la vision en tunnel. Pour moi, la candidate Michèle était la coupable idéale ; tout ce qu’elle faisait confirmait ma conviction. Je suis resté aveugle aux indices qui auraient pu désigner une autre personne. Mon raisonnement illustrait parfaitement le biais de confirmation : la tendance à ne percevoir que les informations qui confirment nos convictions existantes.
J’écartais inconsciemment tout ce qui ne correspondait pas à ce schéma. Dans un jeu comme De Mol, ce biais n’est pas très grave : au pire, on perd un pari (dans mon cas, face à un collègue qui, lui, avait trouvé la bonne taupe).
Mais dans un cadre professionnel, ce biais peut avoir des conséquences bien plus importantes.
Qu’est-ce que le biais de confirmation ?
Le biais de confirmation est une tendance humaine profondément ancrée. Personne n’y échappe : médecins, scientifiques, journalistes… et bien sûr, juristes. Nous voulons tous que notre raisonnement soit cohérent. Convaincus de notre point de vue, nous recherchons activement les faits qui le soutiennent. Les éléments contradictoires sont ignorés, consciemment ou non. Notre cerveau va même jusqu’à effacer ces données discordantes. Nous adaptons les faits à notre théorie, alors qu’il faudrait faire l’inverse.
Cela nous rassure et confirme nos compétences.
Pour un médecin, ce biais peut s’avérer mortel : s’il s’accroche obstinément à une première hypothèse de diagnostic et ignore les symptômes qui ne correspondent pas, cela peut mettre la vie du patient en danger.
Pour les juristes, le risque est tout aussi réel. Pourquoi ? Parce que nous conseillons et prenons des décisions qui ont un impact majeur sur des vies : accorder ou refuser un permis de construire, statuer sur une garde d’enfant, rendre un jugement de relaxe ou de condamnation, recommander ou non un investissement… Qu’on soit juge, avocat, notaire, juriste d’entreprise ou fonctionnaire, si nous nous laissons piéger par notre propre subjectivité, les conséquences peuvent être dramatiques.
La surestimation de soi est la complice idéale du biais de confirmation
Les juristes sont-ils particulièrement vulnérables ?
On croit parfois, à tort, que notre formation universitaire et notre esprit critique nous immunisent contre ces erreurs de raisonnement. En réalité, cela nous rend plus vulnérables. La surestimation de soi est la complice idéale du biais de confirmation. Plus on a d’expérience et de connaissances, plus notre angle mort peut s’élargir.
De plus, notre environnement professionnel regorge de pièges qui renforcent ce biais : la pression du temps pousse à agir en mode automatique et à privilégier les raccourcis mentaux. Le prix Nobel Daniel Kahneman l’explique bien dans Thinking, Fast and Slow : notre cerveau rapide et intuitif prend le dessus sur notre cerveau plus réfléchi et méthodique. C’est dans ces moments-là que le biais de confirmation s’installe insidieusement.
La complexité croissante de notre monde nous incite aussi à rechercher des repères rassurants.
Les réseaux sociaux accentuent encore ce phénomène : leurs algorithmes nous enferment dans des bulles d’opinion où seuls les discours conformes à nos croyances nous parviennent.
Comment y échapper ?
Il n’existe pas de remède miracle. Mais la première étape est la prise de conscience : savoir que nous sommes vulnérables aide déjà. Charles Darwin luttait activement contre ce biais. Il notait scrupuleusement dans un carnet toutes les observations qui contredisaient ses théories et acceptait de les réviser si nécessaire. Il faut aussi oser se remettre sans cesse en question. « Soyez ouvert à l’opinion des autres ». Cela peut paraître un slogan moralisateur, mais c’est une recommandation salutaire.
Même en restant vigilant, on n’est jamais totalement à l’abri. Cela rappelle la loi de Hofstadter : « Tout prend plus de temps que prévu, même quand on prévoit que cela prendra plus de temps ». C’est pareil avec le biais de confirmation : même en anticipant son influence, il persiste.
Pour ma part, je sollicite régulièrement un regard extérieur sur mes idées ou mes textes. L’avis critique d’un collègue peut mettre en évidence les failles de votre raisonnement. C’est parfois déstabilisant, mais toujours enrichissant. Idéalement, choisissez une personne de confiance mais qui ait un parcours différent : une autre spécialité, une autre tranche d’âge, quelqu’un extérieur au monde juridique… Vous pouvez même utiliser ChatGPT comme collègue critique : l’intelligence artificielle est capable de déceler vos points faibles. Ou encore en discuter autour du petit-déjeuner avec vos proches (partenaire, enfants, parents), sans violer bien sûr votre devoir de confidentialité.
Enfin, il y a toujours la sagesse de « dormir sur une décision » : la distance et le recul permettent parfois de voir les choses autrement.
Gardez l’œil ouvert
Le biais de confirmation n’est pas une faute, mais c’est un danger. Surtout pour les juristes, qui naviguent en permanence entre conviction et objectivité. Reconnaître ses angles morts, c’est gagner en crédibilité.
Alors, chers collègues juristes : soyez indulgents avec vous-mêmes, mais impitoyables avec vos propres certitudes. Analysez encore un peu plus ce dossier qui semble parfait. Parfois, les pièces manquantes du puzzle se cachent dans les arguments que vous avez écartés trop vite.
Car seul celui qui accepte de regarder tous les faits en face peut vraiment rendre justice.
Wim Putzeys – rédacteur en chef de Jubel




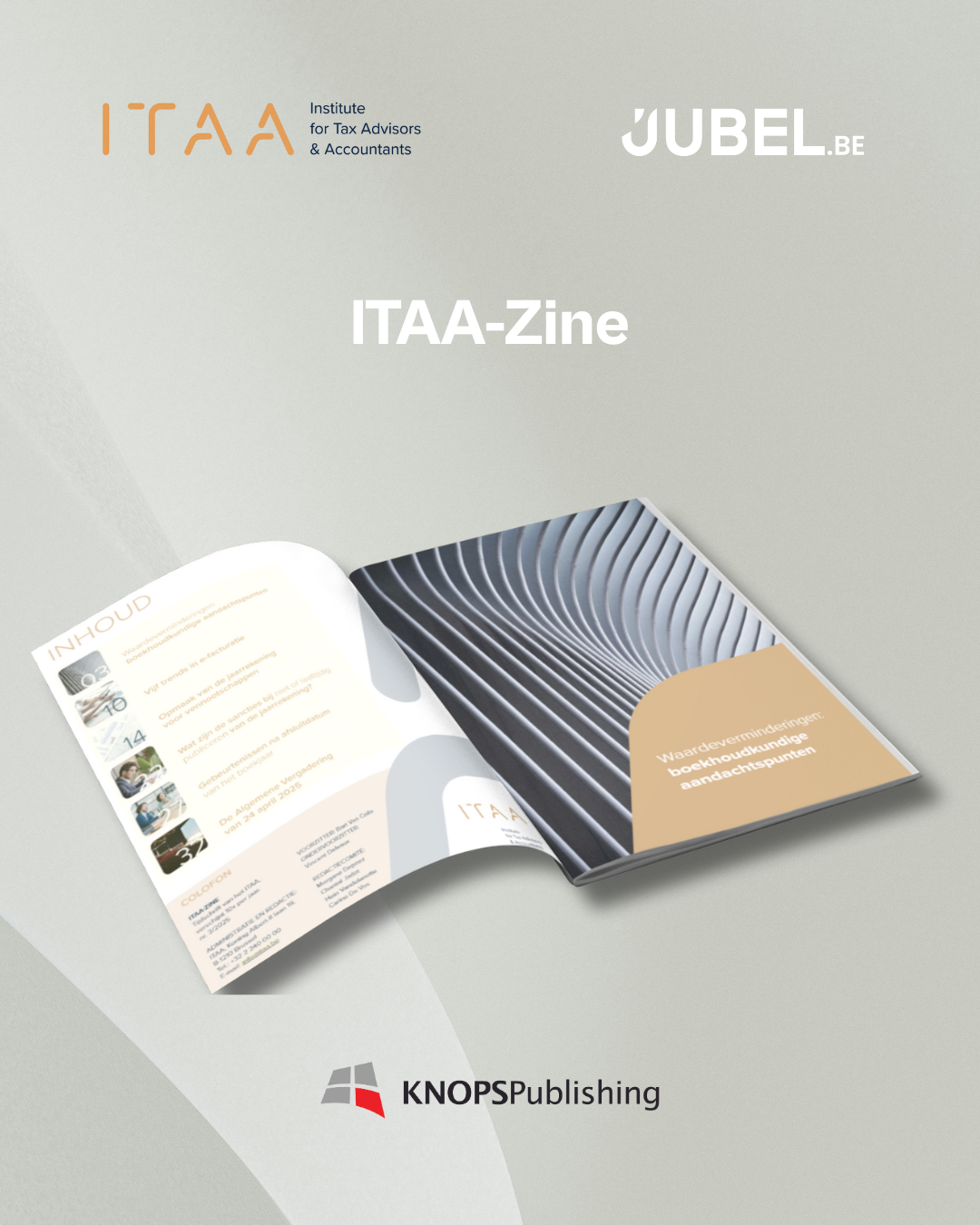
0 commentaires