En juillet, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant à instaurer une taxe sur les plus-values sur actifs financiers. Le gouvernement entend mettre en place cette réforme fiscale importante à partir du 1er janvier 2026. Il convient toutefois de souligner qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de texte, qui fera sans aucun doute encore l’objet de débats politiques et de discussions parlementaires. Certaines modalités d’exécution restent donc à préciser et tous les détails ne sont pas encore définitivement arrêtés.
Il est d’ores et déjà clair qu’un rôle crucial est réservé à l’expert-comptable certifié indépendant. Étant donné que les plus-values historiques antérieures au 31 décembre 2025 sont exemptées de la nouvelle taxe, il faudra déterminer la valeur de référence à cette date. Pour les actifs financiers non cotés, le projet prévoit la possibilité, par dérogation à l’évaluation forfaitaire – basée sur les fonds propres et l’EBITDA – de faire appel à un réviseur d’entreprises ou à un expert-comptable certifié indépendant. Dans ce cadre, l’expert-comptable devient une figure clé dans l’établissement de rapports d’évaluation solides, pouvant servir de preuve en cas de contrôle fiscal ou de litige.
Nous nous penchons sur le projet, mais abordons également la complexité de telles évaluations pour les actifs financiers non cotés.
À qui s’adresse la taxe sur les plus-values ?
La taxe envisagée vise à la fois les personnes physiques (à l’impôt des personnes physiques) et les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales, telles que les ASBL et les fondations privées, lorsqu’elles cèdent des immobilisations financières à titre onéreux. Une exonération s’applique pour les personnes morales reconnues comme institutions habilitées à recevoir des dons fiscalement déductibles conformément à la législation applicable.
Le champ d’application couvre les « instruments financiers » au sens large : actions, obligations (sauf lorsque la taxe Reynders est applicable), ETF, cryptomonnaies, devises, or d’investissement et certains produits d’assurance (branches 21, 23 et 26). Les assurances groupe et les fonds de pension sont exclus du champ d’application.
Concrètement, la taxe sur les plus-values serait due lorsqu’une personne physique ou une ASBL/fondation vend un actif financier, tel que des actions, et réalise à cette occasion une plus-value. L’impôt n’est perçu que sur les plus-values effectivement réalisées : les simples hausses de valeur sans cession effective ne sont donc pas visées.
La plus-value imposable est définie comme la différence positive entre, d’une part, le prix obtenu lors de la cession de l’actif financier et, d’autre part, la valeur d’acquisition initiale (hors frais). Si le prix de vente est inférieur à la valeur d’acquisition initiale, il n’y a pas de plus-value imposable et, dès lors, pas d’impôt dû.
Lorsque la valeur d’acquisition et/ou le prix de cession sont exprimés en devise étrangère, le montant est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur au moment respectivement de l’acquisition et de la cession de l’actif financier concerné.
Les moins-values réalisées pourraient être déduites au cours de la même année fiscale et exclusivement au sein de la même catégorie des actifs financiers. Cela signifie, par exemple, que la perte réalisée sur un produit d’assurance peut être compensée au cours d’une même période imposable par le gain obtenu sur un produit bancaire. Il ne serait toutefois pas possible de déduire ces moins-values d’une plus-value résultant de la cession d’une participation substantielle dans une société.
Des exonérations sont en outre prévues pour les donations, successions et apports à la communauté matrimoniale, mais en cas de vente ultérieure par le bénéficiaire, la valeur d’acquisition historique du détenteur initial est retenue.
Dans l’avant-projet initial, les situations suivantes étaient également considérées comme des cessions :
- le rachat d’un contrat d’assurance avant le décès de l’assuré ;
- le transfert du domicile fiscal ou du siège de la fortune à l’étranger (« exit tax »), impliquant une imposition des plus-values latentes ;
- le transfert d’actifs financiers à des contribuables non-résidents de Belgique.
Dans le nouveau projet de texte, l’« exit tax » est réformée. En cas de transfert du domicile fiscal à l’étranger, le contribuable est tenu de déclarer pendant deux ans ses immobilisations financières ainsi que les éventuelles plus-values réalisées sur celles-ci. De cette manière, l’émigration stratégique à l’étranger pour échapper à la taxe sur les plus-values est découragée. Après l’expiration de cette période de deux ans, l’obligation de déclaration cesse et le contribuable peut en principe s’établir à l’étranger sans conséquences fiscales liées à la taxe sur les plus-values.
Quels sont les taux de la taxe sur les plus-values ?
Dans le projet de texte, trois régimes distincts sont prévus.
Régime général | 10 %
En règle générale, la taxe sur les plus-values s’élèverait à 10 % et serait prélevée à la source (par l’intermédiaire).
Le mécanisme du seuil annuel d’exonération a été affiné dans le nouveau projet. Une exonération de base de 10 000 € par contribuable et par an est prévue. Si cette exonération n’est pas entièrement exploitée une année donnée, la partie non utilisée peut être reportée à concurrence de 1 000 € par an, et ce pendant maximum cinq années consécutives. Ce mécanisme permet aux investisseurs occasionnels de bénéficier d’une exonération allant jusqu’à 15 000 €. De plus, l’exonération de base est indexée annuellement, ce qui lui permet d’évoluer avec l’inflation.
Par ailleurs, l’exonération précédemment proposée pour les actions détenues pendant une période ininterrompue de plus de dix ans est supprimée dans le nouveau projet.
Participation substantielle | Système graduel
Il est question de participation substantielle lorsqu’un contribuable détient au moins 20 % des actions d’une société : dans ce cas, un régime distinct s’applique.
D’une part, un abattement annuel de 1 million € par actionnaire est instauré, lequel ne peut être utilisé qu’une seule fois tous les cinq ans. D’autre part, les plus-values excédant ce seuil d’exonération sont soumises à régime de taxation progressif :
- 1,25 % sur les plus-values entre 1 et 2,5 millions € ;
- 2,5 % sur les plus-values entre 2,5 et 5 millions € ;
- 5 % sur les plus-values entre 5 et 10 millions € ;
- 10 % sur les plus-values supérieures à 10 millions €.
Dans le projet initial, l’exonération de 1 million € pouvait s’appliquer de manière cumulative pour les personnes qui – seules ou conjointement avec des proches ou via des sociétés de contrôle – dépassaient le seuil de 20 %. Dans le nouveau projet, cette exonération s’applique strictement par individu. De plus, la fréquence de l’exonération a été adaptée : elle ne peut plus être utilisée chaque année, mais seulement une fois tous les cinq ans.
Il est important de souligner que les holdings, les sociétés patrimoniales et les sociétés de management peuvent également bénéficier de cette exonération, alors que des propositions antérieures envisageaient d’exclure ce type de sociétés de ce régime favorable.
Pour les actionnaires détenant moins de 20 % des actions, le régime fiscal général reste d’application.
Plus-values internes | 33 %
En cas de cession d’actifs financiers à une société sur laquelle le cédant exerce lui-même le contrôle, directement ou indirectement (cf. article 1:14 du Code des sociétés et associations), une taxe sur les plus-values de 33 % serait due. Les principes relatifs à l’apport d’actions (c’est-à-dire la création d’une réserve taxée en capital) demeurent (provisoirement) inchangés. Cette disposition constitue en réalité une confirmation de la situation de fait actuelle.
Les plus-values historiques sont-elles prises en compte ?
Les plus-values historiques (c.-à-d. antérieures au 1er janvier 2026) restent exonérées. Il est donc essentiel de connaître la valeur des actions au 31 décembre 2025. Pour les acquisitions effectuées avant cette date, deux options existent :
- soit la valeur au 31 décembre 2025 est retenue comme valeur de départ ;
- soit vous pouvez choisir la valeur d’acquisition effective si celle-ci est supérieure. Cette valeur d’acquisition plus élevée peut être utilisée jusqu’au 31 décembre 2030.
La détermination de la valeur au 31 décembre 2025 peut se faire de différentes manières.
a. Immobilisations financières cotées
Le cours de clôture au 31 décembre 2025 peut être utilisé.
b. Immobilisations financières non cotées
La valeur la plus élevée parmi les suivantes peut être retenue :
- la valeur convenue en 2025 lors d’une cession à titre onéreux entre tiers, lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital ;
- la valeur résultant d’une formule d’évaluation déjà utilisée dans un contrat ou une offre contractuelle d’option de vente (effective au 1er janvier 2026) ;
- les fonds propres augmentés de quatre fois l’EBITDA (cf. disposition légale) de l’exercice clôturé avant le 1er janvier 2026.
En alternative à cette dernière méthode, une évaluation peut être réalisée par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié indépendant. Cette évaluation doit alors être effectuée au plus tard le 31 décembre 2026.
c. Options sur actions et actions « in the money »
Pour les actions ou instruments assimilés acquis dans le cadre de la Loi sur les options sur actions du 26 mars 1999, la valeur d’acquisition de l’action serait déterminée sur la base de la valeur au moment de l’exercice de l’option. En outre, la valeur d’acquisition des actions (ou instruments assimilés obtenus avec une réduction de prix dans le cadre de cette loi ou autrement) correspond à la valeur de l’action ou de l’instrument assimilé au moment de l’acquisition.
d. Assurances vie
La base imposable pour les produits d’assurance vie est déterminée par la différence entre le montant perçu et les primes versées.
Rôle de l’expert-comptable certifié indépendant dans le processus d’évaluation
Pour les immobilisations financières non cotées, notamment dans les sociétés et les PME, il est fortement recommandé de fixer au moment de l’entrée en vigueur de la loi une « valeur de départ » ou valeur de référence objective. Cette valeur initiale sert de point de départ pour le calcul de la taxe sur les plus-values lors de cessions futures.
La méthode forfaitaire prévue dans le projet de texte, où l’évaluation est déterminée sur la base des fonds propres augmentés de quatre fois l’EBITDA, est souvent trop simpliste et néglige la complexité de l’entreprise sous-jacente. Cette approche simplifiée laisse de côté des facteurs de valorisation déterminants et peut donc conduire à une base fiscale erronée et dès lors potentiellement sous-optimale.
Il est dès lors fortement conseillé de faire établir une évaluation plus approfondie et nuancée, reflétant la valeur réelle de l’actif financier en tenant compte de tous les paramètres pertinents. Quelques exemples illustratifs :
- La version définitive du texte de loi pourrait prévoir que les comptes annuels déposés servent de base pour la détermination de l’EBITDA et donc pour l’évaluation de l’entreprise. Or, cet EBITDA comptabilisé ne donne pas toujours une image fidèle de la rentabilité opérationnelle réelle. Des événements exceptionnels, des rémunérations non conformes au marché ou des choix comptables spécifiques peuvent fausser le résultat. Dans ce cas, un professionnel peut calculer un EBITDA ajusté et réaliste, mieux aligné sur les performances opérationnelles effectives.
- Très souvent, une start-up n’est pas encore rentable, ce qui entraîne un EBITDA faible (voire négatif). Si l’on applique la méthode consistant à majorer les fonds propres de 4x l’EBITDA, la valeur est dès lors fortement sous-estimée.
- Une société immobilière réalise généralement des chiffres EBITDA relativement faibles, ce qui conduit à une valorisation limitée. De plus, la méthode prescrite par le projet de texte ne tient pas compte de la valeur de marché des biens immobiliers, souvent nettement supérieure à leur valeur comptable inscrite dans les fonds propres.
Ces exemples ne représentent qu’un échantillon restreint des nombreuses situations où la méthode prescrite peut aboutir à une image biaisée.
En outre, une évaluation indépendante offre une base solide ayant une valeur probante certaine vis-à-vis du fisc. L’implication d’un tiers qualifié, tel qu’un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, renforce la transparence et contribue à limiter les risques fiscaux et les éventuelles sanctions en cas de litige.
Défis techniques liés à la valorisation des immobilisations financières non cotées
Valeur vs prix : une distinction cruciale
En pratique, valeur et prix sont souvent considérés comme synonymes, mais c’est une erreur. En réalité, la valorisation est une estimation théorique, basée sur des méthodes et des hypothèses pouvant varier selon les parties.
Le prix, en revanche, résulte d’un processus de négociation. C’est le montant auquel un vendeur est disposé à céder et un acheteur à acquérir. Pour diverses raisons – occasion unique pour l’acheteur, synergies, forte concurrence entre candidats, etc. – ce prix peut diverger de la valorisation.
Trois méthodes d’évaluation couramment utilisées
L’évaluation des sociétés non cotées est une tâche complexe comportant des défis spécifiques. Les actions de PME sont généralement illiquides et non négociées sur un marché réglementé, de sorte qu’il n’existe pas de prix de marché objectif comme référence.
Dans un contexte PME, les évaluations nécessitent souvent une série de normalisations (de l’EBITDA), telles que la correction de charges ou produits exceptionnels[LC1] , de dépenses privées ou de rémunérations non conformes au marché, afin d’obtenir une image réaliste de la rentabilité.
Il convient également de prendre en compte les éléments corporels (terrains, bâtiments, machines) et incorporels (relations clients, savoir-faire, notoriété). L’évaluation aboutit donc généralement à une fourchette de prix plutôt qu’à un montant fixe.
Voici les méthodes les plus utilisées :
a. Valeur substantielle ou intrinsèque
La valeur des actions est basée sur la valeur actuelle de tous les actifs (bâtiments, machines, stocks), après déduction de l’ensemble des dettes de l’entreprise. Dans le cas des sociétés, l’on s’appuie sur le bilan. Il faut également tenir compte de l’impact fiscal des éventuelles plus-values ou moins-values sur les actifs présents. Cette méthode est une technique d’évaluation indiquée dans des cas spécifiques, comme pour une société holding pure ou une société immobilière.
b. Méthode des flux de trésorerie futurs actualisés ou DCF pour Discounted Cash Flow
La méthode DCF part des flux de trésorerie futurs, ramenés à leur valeur actuelle au moyen d’un taux d’intérêt fictif ou CMPC (coût moyen pondéré du capital). Les dettes financières (nettes) doivent en être déduites. L’avantage de cette méthode est qu’elle est prospective et tient compte de la croissance attendue.
c. Méthode des multiples d’EBITDA
Un EBITDA normalisé (résultat avant déduction de la charge d’intérêts, des impôts, des amortissements et des réductions de valeur) est multiplié par un facteur sectoriel (un « multiple »). Les dettes financières (nettes) doivent ici aussi être déduites. Cette méthode est plus simple que la DCF, mais repose sur un multiple solidement étayé, généralement déterminé par comparaison avec des entreprises cotées similaires ou des transactions récentes comparables.
La valorisation n’est donc pas une science exacte. Selon la méthode choisie et les hypothèses retenues, le résultat peut varier sensiblement. C’est pourquoi il est fortement recommandé de comparer plusieurs méthodes et de se faire conseiller par un expert. Une application incorrecte d’une méthode, des normalisations illogiques sur le résultat et/ou le fonds de roulement, ou de mauvaises hypothèses dans les modèles utilisés, peuvent conduire à des résultats fondamentalement divergents.
Anticiper la nouvelle législation
Il est conseillé aux experts-comptables et aux personnes concernées (physiques et morales) de se préparer à temps et de manière proactive à l’introduction de la taxe sur les plus-values. Cela peut se faire en fixant une valeur de départ ou de référence objective au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Cette valeur servira en effet de point de départ pour le calcul des plus-values imposables futures.
Ne pas disposer d’une évaluation argumentée, faite au plus tard fin 2026, expose à des risques fiscaux considérables. Sans valeur de référence claire et établie par un professionnel, le contribuable risque, lors d’une cession ultérieure, de se retrouver confronté à des discussions avec le fisc et/ou à une base imposable erronée si l’on se fonde sur la méthode (trop) simpliste basée sur les fonds propres. Une évaluation correcte, réalisée par un tiers qualifié, offre une sécurité juridique et minimise de tels risques.
De plus, une planification fiscale réfléchie permet de limiter l’impact de la taxe sur les plus-values. Quelques exemples :
- Reporter les distributions de dividendes de l’exercice 2025 à l’exercice 2026 augmentera les fonds propres à la date de référence, réduisant ainsi la plus-value future.
- Pour ceux qui entrent dans le système graduel, étaler les ventes d’actions sur plusieurs années peut alléger la charge fiscale.
- Si une valorisation élevée de la société peut se révéler fiscalement avantageuse dans le cadre de la taxe sur les plus-values, elle n’est pas toujours souhaitable, notamment pour la planification successorale. Il est donc essentiel d’adopter une approche réfléchie afin d’optimiser à la fois l’efficacité fiscale et la transmission du patrimoine.
- Comme mentionné précédemment, l’évaluation des start-ups requiert une approche spécifique. Comme elles passent souvent par plusieurs tours de financement, une valorisation objective au 31 décembre 2025 constitue pour les fondateurs un point de référence précieux. Elle les aide à mieux appréhender les implications fiscales dans les phases ultérieures et à prendre des décisions mûrement réfléchies.
Tant pour l’établissement d’une évaluation correcte et fiable que pour l’élaboration d’une planification fiscale optimale, la collaboration avec un partenaire spécialisé est cruciale. L’assistance d’un conseiller qualifié est indispensable pour parvenir à une valorisation techniquement étayée et susceptible – si nécessaire – de résister à un contrôle fiscal. Un rapport d’évaluation fondé et documenté renforce considérablement la qualité et la solidité juridique du dossier.
Arne Coeman – Expert-comptable fiscaliste certifié, Associé VGD
Lisez ce text dans l’ITAAzine.




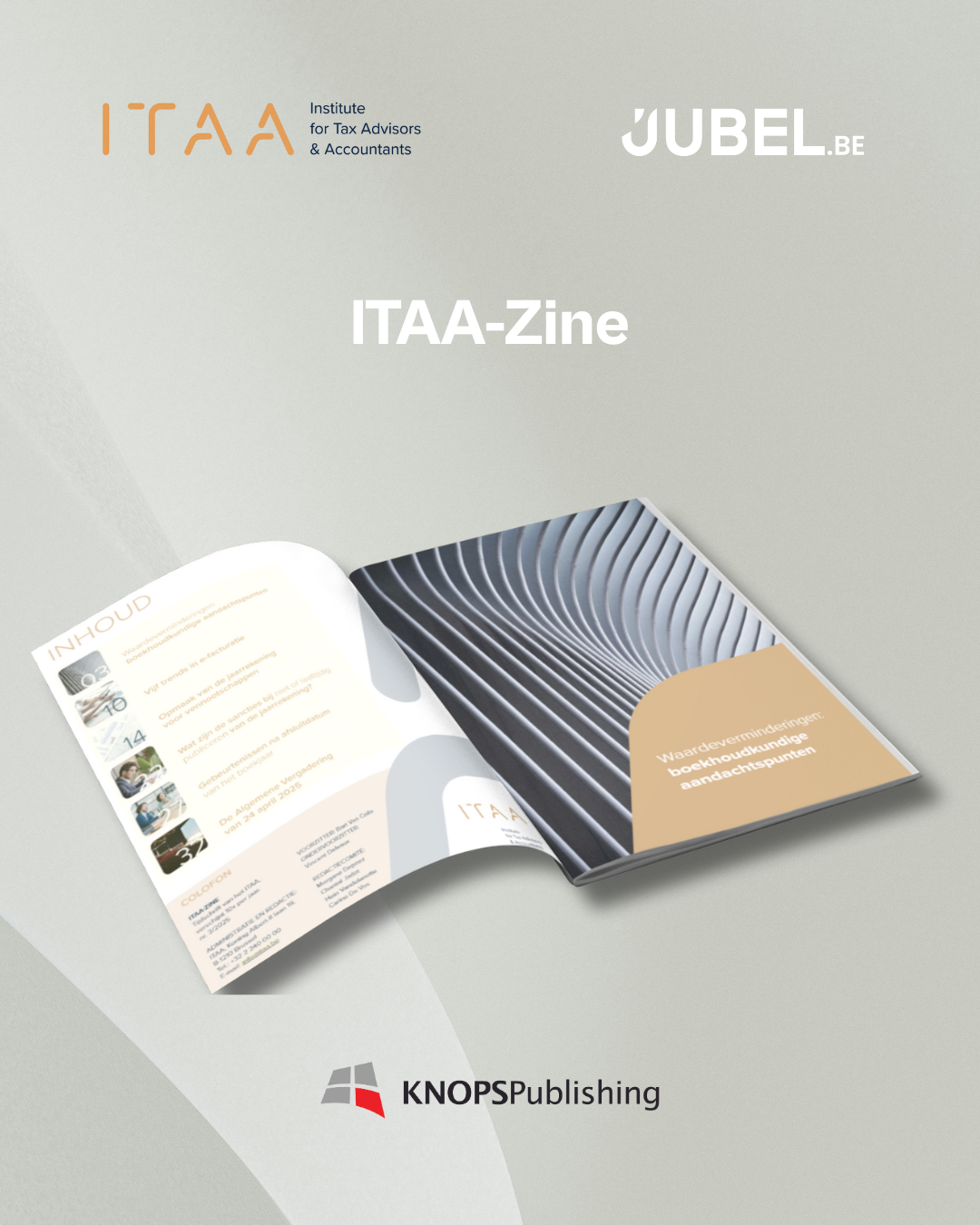
0 commentaires